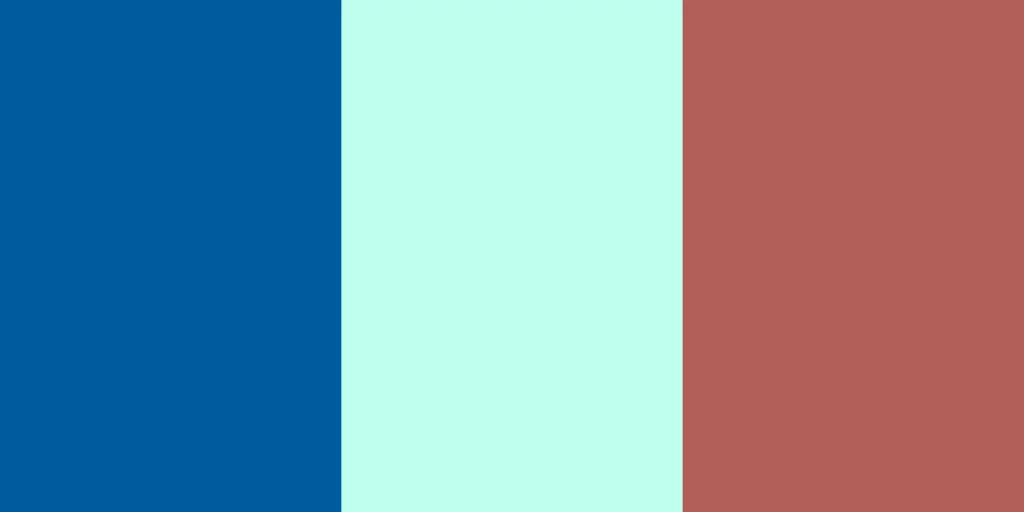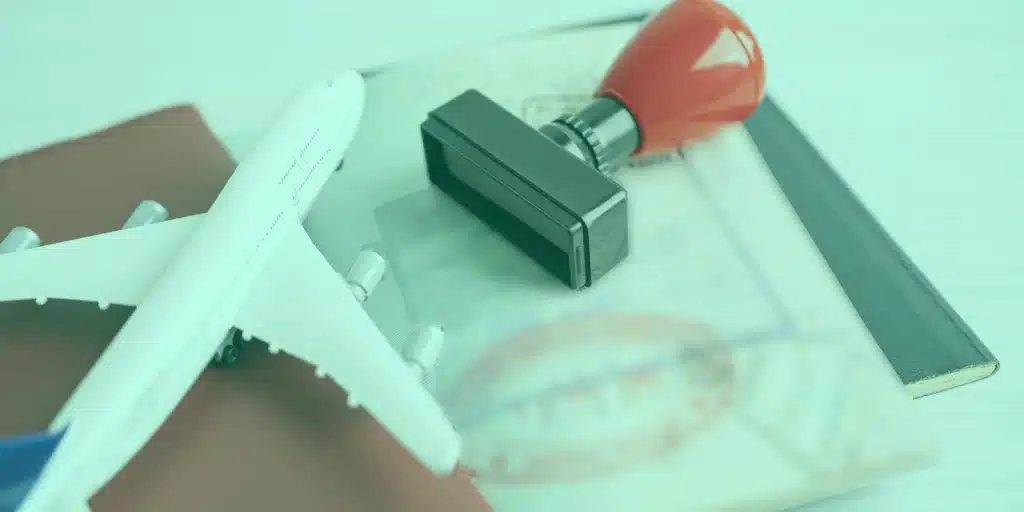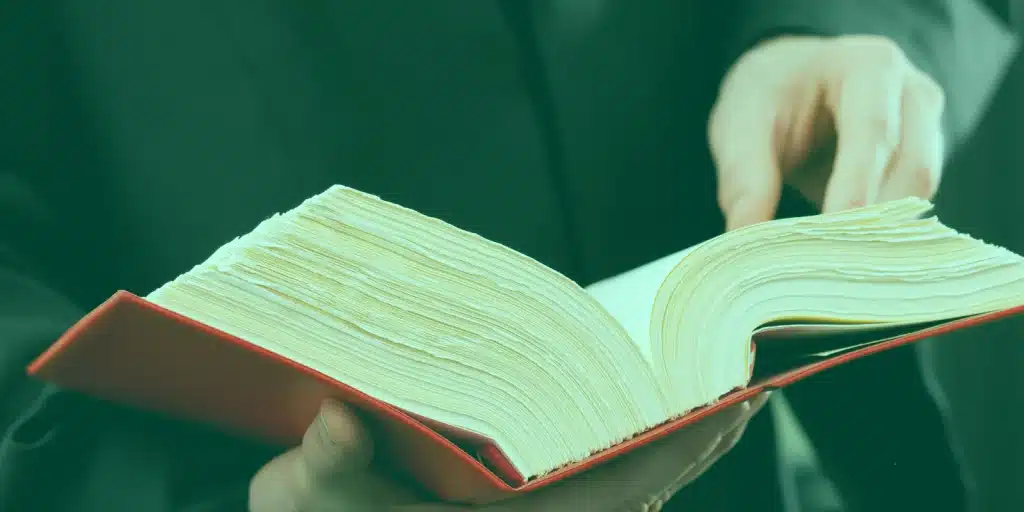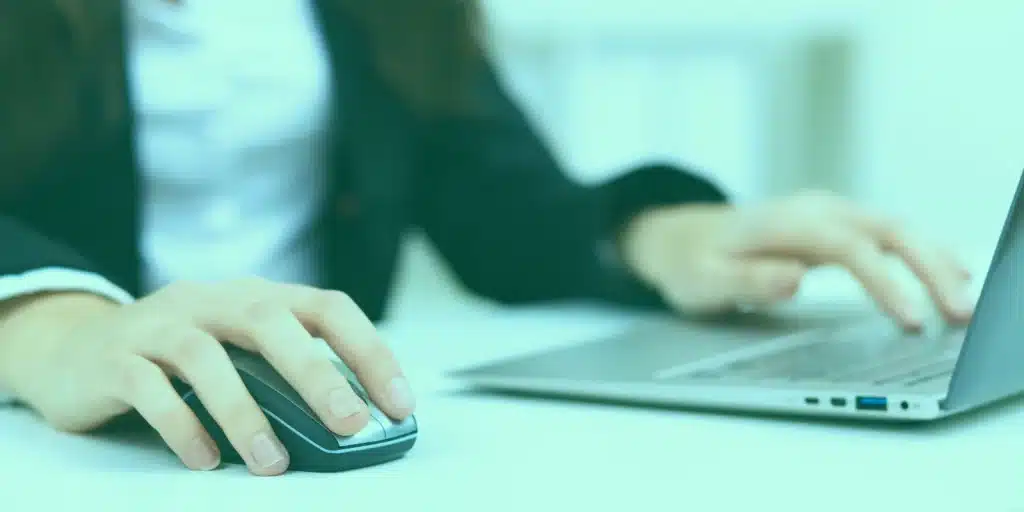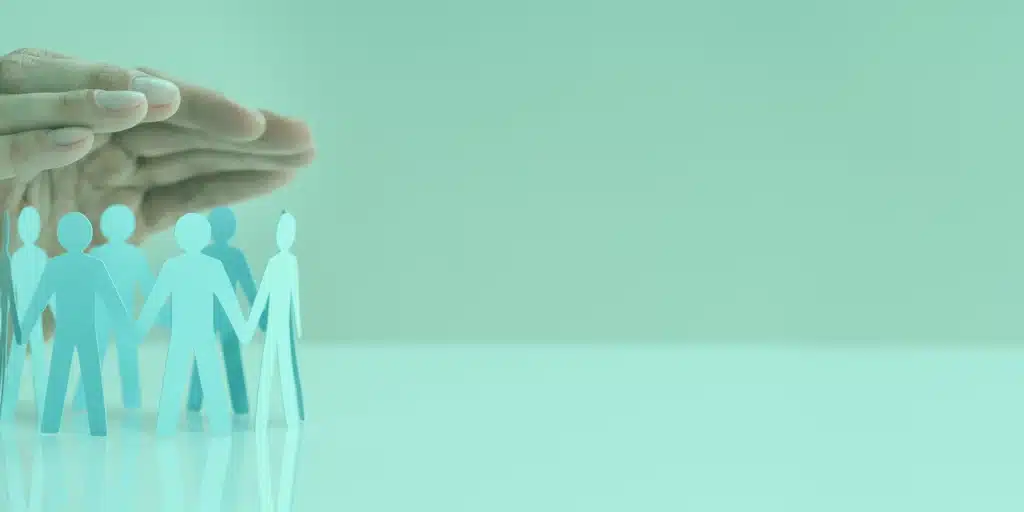Le droit d’asile est un principe juridique permettant d’accorder la protection et le refuge à des personnes qui fuient leur pays d’origine en raison de craintes bien fondées de persécution en raison de leur race, religion, nationalité, appartenance à un groupe social particulier, ou de leurs opinions politiques.
Le droit d’asile est considéré comme un droit fondamental et universel. Il est consacré par des textes internationaux mais aussi en droit interne.
La procédure de reconnaissance du droit d’asile est attribuée à une entité administrative spécialisée, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) mais également à une juridiction spécialisée la cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Dans cet article, il sera proposé une brève présentation des dispositions juridiques consacrant le droit d’asile, mais également la procédure administrative et contentieuse pour obtenir ce droit.
Nous explorerons en profondeur les droits et procédures essentiels pour tout demandeur d’asile en France. Avec la France comme l’un des principaux pays d’accueil en Europe, comprendre le processus d’asile, les rôles de l’OFRA et de la CNDA, ainsi que les délais et recours possibles, est crucial pour les demandeurs. Nous discuterons également des protections alternatives disponibles et de la manière dont les versions récentes des codes juridiques français affectent votre demande. Cet article vise à éclaircir les complexités du droit d’asile et à offrir un aperçu des étapes à suivre pour ceux qui cherchent refuge. En parcourant les différents aspects de la demande d’asile, de la décision initiale jusqu’aux possibilités de recours en cas de refus, nous fournirons les informations clés pour naviguer dans ce processus avec confiance.
La consécration dans l’ordre juridique interne du droit d’asile
Le droit d’asile est un droit fondamental d’octroyer l’asile aux personnes qui remplissent les critères de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Toute personne qui fuit la guerre et les persécutions dans son pays a le droit d’introduire une demande de protection.
L’Union européenne a incorporé les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une protection internationale dans son ordre juridique propre, tout en élargissant le concept en créant une catégorie de bénéficiaires de la protection internationale autre que les réfugiés, à savoir les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire.
En France, ce droit a été consacré par la constitution de 1946, qui consacre le droit pour toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté. Le conseil constitutionnel déduit de l’alinéa 4 du préambule une obligation pour les autorités administratives et judiciaires pour procéder à l’examen de la situation de demandeurs d’asile qui relèvent de cet alinéa.
Ce droit est codifié dans le CESEDA aux articles L.711-1 ET L.711-2.
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public doté de l’autonomie financière et administrative, se voit confier le soin de reconnaître la qualité de réfugié aux demandeurs d’asile. Une juridiction administrative spécialisée, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), est chargée, le cas échéant, de juger en appel les décisions de l’OFPRA (avant 2008, il s’agissait de la Commission de recours des réfugiés).
Les conditions d’obtention
Des critères cumulatifs liés à la crainte des persécutions sont donc exigés pour permettre l’octroi du statut de réfugié à un candidat d’asile : les persécutions doivent être strictement personnelles, actuelles, réelles et atteindre un seuil de gravité suffisant.
La crainte de persécutions personnelles
Cette notion peut s’entendre largement au sens qu’elle dépasse l’individu et englobe le noyau familial.
Des persécutions ou des craintes de persécutions actuelles et réelles
Il n’est pas imposé au demandeur d’asile de faire état d’une persécution effective, c’est-à-dire réalisée. Pour cette raison, une personne qui bien que n’ayant elle-même jamais été persécutée, peut être admise au statut de réfugiée si elle établit que des violences ont été infligées à plusieurs membres de sa famille (CE, 10 Juillet 1996, Ranamukage).
Le risque avéré de persécutions peut ainsi suffire à octroyer l’asile, cependant il faut que le risque de persécution ne soit pas seulement potentiel mais réel et actuel au moment du dépôt de la demande.
Des persécutions d’un certain degré de gravité
Le critère de gravité peut être mis en exergue de plusieurs façons. A cet égard, la jurisprudence est d’une aide particulière pour comprendre le seuil d’admission même s’il est toujours apprécié in concreto :
● L’atteinte avérée à l’intégrité physique satisfait par essence aux exigences de la convention de Genève, par exemple les actes de torture physiques.
● La privation de liberté durable infligée en dehors de tout jugement constitue une persécution grave.
● A contrario, l’engagement d’une procédure judiciaire ne constitue pas systématiquement une persécution grave. Il faut démontrer le caractère arbitraire, systématique, injustifiée de la procédure et qui entraine des conséquences durables (ex : Commission de recours des réfugiés, 6 avril 2005, n°436054, Z).

Les clauses d’exclusions
L’article 1 de la Convention de Genève exclut de son champ d’application des personnes qui, même en établissant des persécutions, sont coupables d’un certain nombre de comportements jugés incompatibles avec le statut de réfugié (crime contre la paix de guerre, ou pour humanité).
Par exemple, un demandeur d’asile ancien officier de l’armée burundaise, responsable de crime de guerre en 2001, ne peut se voir reconnaitre le statut de réfugié même s’il est menacé de persécutions graves du fait de son appartenance ethnique (CNDA, 28 janv 2020, M.N, N°18001989).
Le CESEDA a également introduit une clause pour exclure le candidat dont la présence constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat, ou condamnée en France pour un crime ou délit constituant un acte de terrorisme puni de dix ans d’emprisonnement.
La protection subsidiaire
La loi du 10 décembre 2003 a consacré une nouvelle forme de protection palliant l’impossibilité de conférer le statut de réfugié à une personne ne présentant pas de persécutions strictement personnelles codifiée à l’article L.712-1 DU CESEDA.
La demande de protection subsidiaire est examinée dans l’hypothèse où la reconnaissance du statut de réfugié est rejetée. La procédure de demande suit les mêmes modalités que la procédure d’asile présentée ci-dessous. Le juge pourra alors conférer le statut de protection subsidiaire dans le cas d’un refus d’asile.
Quels sont les droits du demandeurs d’asile ?
● Le droit de rester en France pendant l’examen de la demande. Une personne est munie d’une autorisation de séjour (appelée attestation de demande d’asile) d’une durée variable et qui lui permet d’’être en situation régulière et de circuler sur l’ensemble du territoire mais non de franchir les frontières même dans l’espace Schengen. Cette attestation peut être refusée ou retirée dans certaines situations en fonction de la procédure qui est appliquée
● Le droit à des conditions matérielles d’accueil comprenant un hébergement, une allocation d’un montant calculé selon le nombre de personnes composant la famille de la personne et l’absence ou non d’hébergement gratuit. Ces conditions peuvent être refusées ou retirées dans certains cas.
● Le droit à une domiciliation, à une aide sociale et juridique pendant la procédure ;
● Le droit de bénéficier d’une assurance maladie mais seulement après trois mois de résidence en France ;
● Le droit de travailler si la personne n’a pas reçu de réponse à sa demande dans un délai de six mois après son enregistrement et si elle est autorisée par le préfet. (Ce qui est rarement le cas). La personne peut aussi recevoir une formation professionnelle mais non de suivre des études universitaires ;
● Le droit de s’exprimer : Contrairement à une idée reçue, un demandeur d’asile peut librement s’exprimer, rejoindre une association ou un parti mais dans les limites prévues par la loi (pas d’incitation à la violence ou de tenir des propos haineux).
● La liberté d’avoir une vie privée et familiale, par exemple de se marier (même si son statut précaire complique les démarches) sauf s’il s’agit d’une union polygame

La procédure de droit d’asile
La procédure pour l’obtention du droit d’asile comporte une part administrative devant l’OFPRA, mais également contentieuse en cas de refus devant la CNDA.
La procédure administrative du droit d’asile
Pour obtenir le droit d’asile en France, la personne doit déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Cet organisme est compétent pour examiner les demandes de reconnaissance de statut de réfugié et les demandes de protection subsidiaire.
Avant chaque saisine de l’OFPRA, chaque demandeur d’asile doit se présenter en préfecture du lieu de résidence pour voir ses empreintes enregistrées dans le fichier EURODAC.
La préfecture délivre le dossier à renvoyer dans les 21 jours contenant les informations relatives l’identité du demandeur ainsi que le récit complet de son histoire, ses craintes des persécutions, ainsi que toute preuve de nature à corroborer ses propos.
La demande peut être soumise à la frontière ou sur le territoire français, mais il est préférable de la faire dès que possible après l’arrivée en France.
Une fois la demande d’asile déposée, l’OFPRA convoquera le demandeur pour un entretien au cours duquel il devra expliquer les raisons pour lesquelles il craint la persécution dans son pays d’origine. Le demandeur peut s’il le souhaite être accompagné d’un avocat ou d’un représentant d’une association spécialisé. L’OFPRA examinera ensuite les éléments de preuve fournis par le demandeur pour évaluer sa demande.
L’OFPRA rendra une décision concernant la demande d’asile. Si la demande est acceptée, le demandeur obtiendra le statut de réfugié en France. L’octroi de ce statut donne droit à une carte de dix ans.
La procédure contentieuse du droit d’asile
Si elle est rejetée, le demandeur peut former un recours de la décision devant la Commission nationale de l’asile (CNDA). Toute décision prise par le directeur général de l’OFPRA peut faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
En cas de rejet par l’OFPRA, le demandeur a la possibilité de faire appel devant la CNDA, qui est une juridiction spécialisé chargée de réexaminer la décision de l’OFPRA.
Le recours contre une décision du directeur général de l’OFPRA doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de cette décision.Le CNDA peut décider d’octroyer le statut de réfugié ou rejeter la demande. Le demandeur d’asile est alors débouté.
Un pouvoir en cassation devant le Conseil d’Etat, dans les deux mois de la notification de la décision de la CNDA est recevable.
Que retenir sur le droit d’asile ?
Le droit d’asile est une protection accordée par un État à des individus qui fuient leur pays d’origine en raison de persécutions ou de craintes fondées de persécution. Ces persécutions peuvent être liées à la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social, ou les opinions politiques de l’individu. Pour bénéficier de cette protection, le demandeur doit prouver qu’il ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de son pays d’origine à cause de ces persécutions.
En France, la procédure de demande d’asile implique que le demandeur se trouve sur le sol français pour pouvoir déposer sa demande auprès d’une préfecture, qui lui délivrera un document attestant de son statut de demandeur d’asile. Cette démarche initie l’examen de la demande par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et, en cas de recours, par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
La demande d’asile devient une des seules voies d’entrée en France, d’autant plus attractive que, dans le même temps, les droits sociaux reconnus aux réfugiés et demandeurs d’asile sont plus nombreux. Les réfugiés statutaires bénéficient de prestations familiales et de l’allocation logement, du droit au minimum vieillesse et à l’allocation adultes handicapés.
La loi « asile et immigration » du 10 septembre 2018 introduit plusieurs dispositions relatives aux droits des demandeurs d’asile en France, notamment la possibilité d’engager une action en paiement en cas de non-versement des allocations auxquelles ils ont droit durant l’examen de leur demande.
Ce résumé met en évidence le cadre législatif et procédural qui régit le droit d’asile en France, soulignant l’importance de la protection offerte aux individus confrontés à des situations de persécution dans leur pays d’origine.
Afin d’obtenir des informations supplémentaires sur le droit d’asile, prenez contact avec un avocat via notre plateforme. Les références légales sont à jour au moment de la publication, pour votre cas personnel, pensez à consulter un avocat expert.
FAQ sur le droit d’asile
Dans cette FAQ, vous pouvez trouver les questions les plus fréquemment posées sur le droit d’asile.
Le droit d’asile est une protection accordée par un pays à des personnes qui fuient leur pays d’origine pour des raisons de persécution, de conflits, de violence ou d’autres circonstances qui mettent gravement en danger leur vie, leur liberté ou leur sécurité.
Pour demander l’asile en France, vous devez vous trouver sur le territoire français et vous adresser à une préfecture pour déposer votre demande. Vous recevrez alors un formulaire à remplir et des instructions sur les prochaines étapes du processus.
Toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques peut demander l’asile.
Les demandeurs d’asile en France ont le droit de résider dans la région désignée par l’OFII durant l’examen de leur demande. Ils ont également accès à certains services sociaux et peuvent demander une autorisation de travail sous conditions.
Une fois votre demande déposée, vous serez convoqué pour un entretien individuel où vous devrez expliquer les raisons de votre demande. Votre cas sera ensuite examiné par l’OFPRA ou la CNDA, qui décidera de vous accorder ou non le statut de réfugié.
Votre demande d’asile peut aboutir à trois résultats principaux : l’octroi du statut de réfugié, la protection subsidiaire, ou le rejet de votre demande. En cas de rejet, vous avez le droit de faire appel devant la CNDA.
Oui, sous certaines conditions, les demandeurs d’asile peuvent demander une autorisation de travail en France s’ils n’ont pas reçu de décision sur leur demande dans les 6 mois suivant leur dépôt.